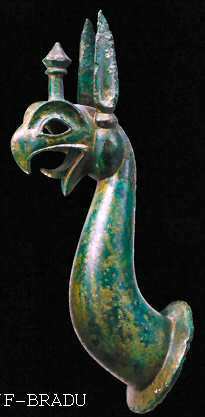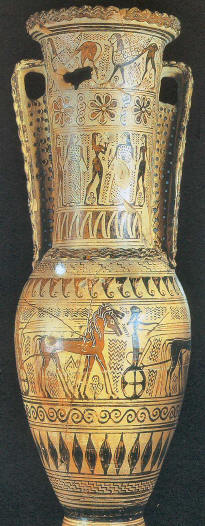|
|
Le musée de l'Acropole
 |
ATHÈNES :
le musée de l'Acropole 5/64 -
La période archaïque : les
offrandes |
 |
Les frontons et les koré de la période archaïque du
musée de l'Acropole font en grande partie sa renommée. Ces sculptures détériorées
appartenaient à l'Acropole avant sa destruction par les Perses en 480 av.
J.-C. Elles ont été enterrées pieusement (offrandes) par les
Athéniens dans l'enceinte de l'Acropole (le téménos). C'est ainsi que l'on
doit paradoxalement leur conservation à un acte de destruction.
|
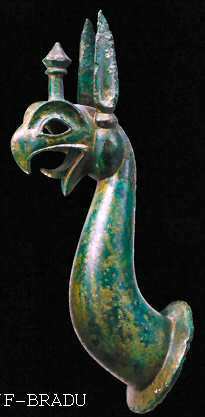
|
Toutefois, ces offrandes à Athéna Polias n'étaient
pas une nouveauté, les premières remontent au VIII° siècle av. J.-C. Il
s'agissait alors d'offrandes votives de
chaudrons en bronze
montés sur trépieds. Les anses de ces chaudrons sont décorées de chevaux et
de figurines masculines. Au VII° siècle, les chaudrons suivent la mode
orientale (de Babylone) en s'ornant de griffons et sirènes. Il faudra
attendre la fin du VII° siècle av. J.-C. pour les premières offrandes en
marbre sous la forme de bassins lustraux.
La
tête de griffon* ci-contre, a été réalisée avec la technique de la fonte
à la cire perdue dont les Grecs apprirent à maîtriser le procédé auprès
des bronziers orientaux. Ce griffon décorait, avec cinq autres têtes du
même genre, le col d'un chaudron en bronze martelé. Ce type de chaudron
pouvait atteindre des tailles énormes, Hérodote parle d'un chaudron de
10 000 litres destiné au roi de Lydie, Crésus.
* griffon :
monstre fabuleux originaire de l'est avec un corps de lion et une tête
d'aigle.
Griffon ci-contre :
Musée
Barbier-Mueller Genève
Origine : Péloponnèse ou Samos (temple d'Héra) - 610-600 av.
J.-C.) - H : 16,8 cm.
|
|
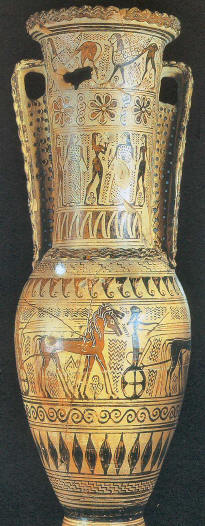 |
A la même époque, les Athéniens déposaient d'autres types d'offrandes sur
l'Acropole, tels les
loutrophores qu'on a trouvées en grand nombre
près du petit sanctuaire dédié aux nymphes du mariage. La loutrophore
est un vase rituel à grand col dans lequel on transportait l'eau
utilisée pour les bains nuptiaux. L'eau était apportée par les amies de
la mariée depuis la source Callirrhoé (près de la rivière Illisos) qui
passait pour favoriser la fertilité.
Dans les tombes, on trouve un autre type de loutrophore
utilisé pour la toilette du mort. Le fond du vase est percé pour
permettre la communication avec le mort, le décor de serpents sur
l'embouchure et les anses confirme la fonction funéraire (le serpent
étant associé au monde souterrain des enfers). Le décor de la panse est
divisé en registres superposés alternant motifs
décoratifs (sphinx, rosettes, tresses, dents de loup, motifs en
escalier, spirales, pétales) et scènes figurées (couples dansant au son
de la double flûte, défilé de chars).
Ce type de vase
fait
la transition entre l'époque géométrique (motifs abstraits, défilé de
chars) et l'époque orientalisante (sphinges, rosettes, tresses,
importance de la figure humaine) qui marque le VIIe siècle av. J.-C.
Loutrophore ci-contre :
Musée du Louvre
Origine : Athènes - Vers 690 av. J.-C. - H
: 80 cm ; D : 27,50 cm.
Peintre d'Analatos (peintre
anonyme, appelé par convention de cette façon, lieu de découverte en
Attique d’une de ses productions -
hydrie - au
début de sa carrière).
Cliquez
pour agrandir le vase. |
|
La
croissance des offrandes
Les offrandes sont encore assez rares jusqu'au
milieu du VI° s av. J.-C., elles deviennent très abondantes entre -525 à
-480. L'augmentation des offrandes suit sans doute la prospérité d'Athènes
qui s'accroît à partir de -570. Mais il est aussi à remarquer que les
offrandes s'accroissent fortement après la mort de Pisistrate (-528). Il y a
donc sans doute aussi une raison politique à la multiplication des
offrandes. Les fils de Pisistrate auraient pu ouvrir l'accès à l'Acropole à
l'aristocratie après une certaine réconciliation. La bourgeoisie
s'enrichissant aurait pu aussi accéder aux offrandes sur l'Acropole alors
qu'elle en était exclue auparavant.
Pourquoi des offrandes ?
L'offrande c'est une pratique qui consiste à offrir
un objet conséquent à un dieu à l'occasion d'un événement heureux pour
plaire au dieu, le remercier ou lui demander une faveur. Mais cet acte de
piété du dédicant (celui qui offre) flatte aussi sa vanité car si l'objet
consacré est désormais la propriété de la divinité, il reste aux yeux de
tous dans le sanctuaire et profite à la notoriété du donateur, il montre sa
richesse et sa générosité.
Les offrandes, à quelle occasion ?
Les offrandes à cette époque correspondent le plus
souvent à la dîme d'une somme acquise (cela peut être le butin d'une
victoire) ou les prémices d'une récolte ou d'une activité nouvelle.
Les auteurs des offrandes ?
Selon les inscriptions dédicatoires, la plupart des
offrandes ont une origine privée, la première dédicace publique date de
-505, elle commémore la première victoire militaire du régime démocratique.
Après la mort de Pisistrate, la plupart des offrandes proviennent
d'artisans modestes*, notamment de céramistes qui rendent hommage à leur
déesse Athéna Ergané (protectrice du travail manuel). Les offrandes
aristocratiques, moins nombreuses**, concernent des distinctions, les
offrandes bourgeoises, une réussite. Toutes les classes sociales participent
donc aux offrandes sur l'Acropole mais elles sont diversifiées en fonction
du statut social
* on trouve des
lavandières, des vendeuses de pain
**
ce qui est
une particularité de l'Acropole par rapport aux autres grands sanctuaires
Le matériau utilisé pour les offrandes ?
Tous les matériaux existants ont été utilisés, mais ici
encore il y a une hiérarchie en fonction de la classe sociale ; céramique,
bois, pierre, bronze, métaux précieux.
- la céramique :
Les offrandes en terre cuite sont les plus communes compte tenu de
l'abondance de l'argile en Attique. Les vases dédiés à Athéna étaient sans
doute conservés dans des lieux abrités et peut-être clos. Les plaques en
terre cuite peintes étaient accrochées, elles représentent le plus souvent
Athéna, certaines étaient même faites en série (Athéna Promachos sur son
char). Des petites figurines peintes de couleurs vives et représentant une
coré debout, tenant un bouton de fleur sur la poitrine, étaient faites en
très grandes séries.
- le bois :
Les offrandes en bois sont attestées par les écrits, elles étaient
nombreuses et parfois précieuses : instruments de musique, coffres ouvragés,
statues peintes, sans oublier la célèbre statue d'Athéna Polias.
- le bronze :
Le bronze restera l'offrande la plus prestigieuse jusqu'à la fin du IV° s
av. J.-C. La mode des chaudrons sur trépied passée, on trouve de la
vaisselle en bronze, surtout des patères. Les femmes offrent assez souvent
des miroirs à manche figurés, un couros levant les bras. Les figurines
représentant Athéna Promachos (guerrière), casquée tenant le bouclier et
brandissant la lance, sont très nombreuses. Toutefois, la coutume d'offrir à
une divinité une statue de son sexe (donc féminine pour Athéna) est tempérée
par l'existences des concours sportifs panathénaïques qui ne concernent que
les hommes. Ceux-ci, pour commémorer leur victoire, décernent une statue de
couros.
- La pierre
Jusqu'à la fin du VI°siècle av. J.-C., la sculpture monumentale reste en
calcaire tendre (poros) tandis que les statues en ronde-bosse utilisent le
marbre de Naxos (les deux premières statues de femme conservées datent de
vers -570 et sont sans doute des importations). Ce n'est qu'au V° siècle av.
J.-C. que le marbre du Pentélique est utilisé. |
Compte tenu des nombreux piratages du site, le click droit pour le copiage du texte et des images est dorénavant interdit. Site sous copyright.
Les élèves peuvent cependant récupérer les images à l'aide d'une copie d'écran pour leurs travaux pédagogiques non lucratifs et non publiables, y compris sur Internet.
Pour tout autre usage, contacter l'auteur:Contact
|